L'invention de l'année 2018
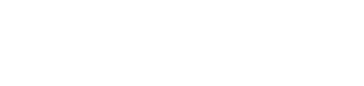
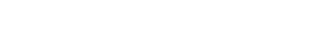
à l'Ecole Normale Supérieure, Salle Béatrix Dussane
45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Ombre de la projection du13 Janvier 2017
Un film, 1h 33min, 2017, extrait
scénario inspiré par Charles Péguy

déchiffrage
films
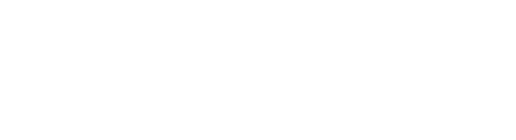
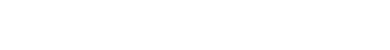


Flagrant délit de
extrait 1
Fin, maintenant,
sur L’Invention de l'année 2018
par Anne Schneider
« Maintenant ». Le film s’ouvre sur ce mot, indiquant clairement un projet de capture du présent. Mais aussitôt s’amorce un décalage : apparaissent les quais de Seine recouverts de neige, pendant qu’une voix off, féminine, énonce : « Maintenant, c’est juillet », avant de répéter cette phrase, cette fois dans une adéquation image-son, sur la Place de la Concorde, et sous un soleil qui pourrait effectivement être celui de juillet. Il n’empêche, le spectateur est prévenu : le cinéma peut tout, il n’est pas contraint à une illustration servile de ce qui est montré par ce qui est dit. Face à un film de Jean Seban, le regardant accepte de s’embarquer sur une mer qui se réserve le droit d’être houleuse, joueuse, et de le ballotter à son gré.
La métaphore aquatique ne survient pas par hasard : l’eau, douce ou salée, de rivière ou de mer, constitue un fil conducteur qui court à travers le cinéma de Jean Seban, dans nombre de ses films. Elle entraîne la pensée, au son d’une rivière qui précipite le film vers sa suite.
Film qui se présente découpé en chapitres. Le premier, « Juin 2013. Invention n°1/XII. Portrait à l’ascenseur avec père et mère. XXIème s. », montre l’image du couple parental, entrouvrant puis refermant une porte. Un bruit d’eau courante, puis une image de rivière se superposent à eux, menaçant d’emporter ces visages aimés, déjà vulnérables. On l’a compris : tout coule. Et eux seront entraînés également. Mais Jean Seban ne prêche pas pour une banale acceptation de cet état de fait. En témoignent cet agrippement forcené aux visages, ces longs plans sur un œil démesuré, sur des lèvres mortelles, bien que jeunes et se faisant médiatrices de textes littéraires qui hantent et rythment le film ; sur des mains âgées, l’une heurtant de ses riches bagues une paroi de métal, martelant un refus dérisoire du risque qui plane sur elle ; les autres, deux, l’une aux ongles vernis, l’autre aux ongles nus, se cherchant et se nouant.
Les chapitres se succèdent, et les mois avec eux, suivant alors une sage chronologie qui nous aura conduits de juin 2013 à mai 2014, accompagnant donc une année. Mais quelle année ? Celle qui aura vu la naissance d’un enfant, annoncée dans l’ « Invention n°5/XII. Octobre 2013. Portrait de deux fils et une fille » : « Il naîtra le mois prochain » passe soudain sur l’écran.
Et l’on comprend qu’il est question de cela, du rythme de la vie et de la mort, de cette eau toujours affairée qui apporte ou emporte, et que le réalisateur-poète s’emploie à métaphoriser en une succession d’images s’enchaînant à la manière d’un flux mental.
L’eau court, poursuit son babil, parfois cruel - Jean Seban donne à voir des images de guerre, un patineur tombé sur la glace, où son corps glisse comme un galet inerte, et dont le bras, une fois la glissade arrêtée, se tend désespérément vers le bandeau où s’inscrit le nom de la ville olympique -, parfois débordant d’humour - un plan sur l’image du nouveau-né endormi, une voix off énonçant : « Un despote. Un vrai despote », dans « Invention n°10/XI. Portrait d’un dieu. XXIème s. » -, parfois ironiquement méditatif - une galaxie tournoie dans un écran télévisé et semble produite par le bec de la théière placée devant ce poste à images...
Le flux intègre d’anciens films super 8, renvoyant à une autre enfance. Fuite éperdue du temps, de l’eau, qui revient toujours à l’image, toujours vive, jamais stagnante, jamais celle dans laquelle s’est absorbée Mouchette, l’héroïne de Bernanos. Cette eau court, va de l’avant, joue avec les garçonnets qui s’imaginent naïvement que ce sont eux qui jouent avec elle, court vers le futur, vers l’année qui se construit, invente « l’Année 2018 »... On n’est pas surpris que le film se referme sur l’image du père, répétant, face caméra : « Je voudrais nager. Je voudrais de nouveau nager ». Cet homme semble savoir, avec son fils, dans quel élément se meut la divinité. « Fin. Maintenant ».
Le film ne cache rien, le titre de l’œuvre nous dit tout, il nous dit ce que nous ne devons pas refuser d’entendre : non pas représentation, mais Invention. Le monde n’est plus ici un spectacle que l’art confierait à notre regard indiscret, regard sur le monde mais protégé de ses anfractuosités, immunisé contre son écoulement sans répit, contre son souffle qui ne laisse rien indemne. Dans le film L’invention de l’année 2018 le monde s’offre tel qu’en lui-même nous sommes, tel qu’en lui-même nous vivons, souffrons, désirons, non comme un monde déjà fait, définitif, que nous n’avons plus qu’à contempler, mais comme cet infini qui n’est rien hors de la durée où il s’invente et s’incarne, hors des êtres chargés de passé et d’avenir dans les yeux desquels il se reflète, hors de la vie qui se consume en lui et qui le traverse partout d’un unique mouvement. Monde : pas simplement une grande scène, ou une immense collection de choses, mais siècles, années, mois, jours, secondes, prenant chaque fois le nom du temps où nous séjournons. C’est cela que nous montre, que nous donne à vivre le cinéaste : la singularité du temps, la naissance de chaque instant, la beauté unique du monde que chantent les visages les plus divers, comme des vagues conspirant à nous faire entendre la scansion profonde de l’océan de l’être ; comme la croissance interne dans une perpétuelle épiphanie des vers de Charles Péguy.
Qui ne respire ici un air déconcertant ? Dans l’approche de cette œuvre, nous sentons que les mots perdent leur sens habituel. Quand ? Question aux couleurs d’énigme dans un monde qui dure, où maintenant désigne le seuil vibrant d’un acte de création. Où ? Question aux couleurs d’énigme dans un monde d’images, fenêtres sur des lieux autres, sur des temps autres, sur un ailleurs qui ne peut renoncer à se rendre proche. Qui ? Qui est toi, qui est moi, si tout s’invente à chaque instant ? si le moi, le monde et le temps, si l’œuvre autant que celui à qui elle se destine disparaissent sans cesse pour renaître sans cesse, dans la fulgurance d’une invention perpétuelle ?
Car lorsque retentit l’ultime question – Qui donc me parle ici ? –, au cœur de ce monde étrange qui se dévoile à moi, surgit un vide : à ce monde manque l’Unique, qui n’apparaît que de son absence même, Lui à qui toutes les images s’adressent et se réfèrent, Lui que toutes les paroles concernent, Lui qu’entoure cet univers, et qui le porte par ses sens, par sa mémoire, par son désir. Lui… Mais de qui s’agit-il ? Puis-je encore sincèrement, en ce maintenant où je vois à travers ces yeux eux-mêmes invisibles, poser cette question ? Je peine à combler le vide par le souvenir d’un nom, expédient misérable dans ce monde où tous les noms sont devenus dérisoires, où tous les mots sont devenus énigme. Je le vois bien d’ailleurs : aucun fil d’Ariane ne se laisse saisir dans ce labyrinthe, nul ne m’offre son visage pour que je puisse y lire ce que je dois éprouver ; mais l’insaisissable lien que je cherche, ce lien qui tisse les images et les sons en un texte inouï, est au cœur de ce vide que dessine l’œuvre en son envers, qui est, je le sens, à la place même où je me trouve ; vide que je ne saurais contempler, mais que je ne peux que remplir de ma propre chair et habiter, auquel je dois confier mon être pour que s’accomplisse le sens suprême de l’œuvre : que mon être même parvienne en ce vide à renaître… réinventé. Et c’est le pathos même du temps qui se transforme maintenant. Car le temps, mon temps, ne saurait désormais se ressentir encore comme la perte irrémédiable dont il avait toujours constitué le parfait symbole, sa course ne poursuit plus l’aveugle dévoration de l’être qu’un miracle seul pourrait racheter, mais son sens même, son œuvre intime est, à chacun de ses battements, le miracle même : une résurrection.
Dans cet échange, dans cette Transsubstantiation par l’art qu’opère l’Invention de l’année 2018 les frontières du Moi et de l’Autre s’effacent : la puissante singularité de l’œuvre, l’expression radicalement intime d’un univers si personnel ne nous exclut pas mais au contraire nous convoque dans notre propre singularité, – à ne délaisser que notre confort de spectateur, que notre regard de divinité chimérique, et à accepter d’être soi-même – expérience sans pareille – regardé par l’œuvre.
Pauline Donizeau et Sarah Bertholon et Fac Me Vere Tecum Flere et Joseph Haydn et Titi Parant et Domenico Capotorto et La Passion selon saint Matthieu et Antonio Caldara et la Madeleine aux pieds du christ et Robert Seban et le samedi 5 octobre 2013 et Claire Daudin et François Haye et Jennifer Kilore-Caradec et la Promesse d'Octobre et Thomas Ducasse et Pénélope Driant et Agathe Fredonnet et le premier prélude en do majeur et Laurent Montel et Sterenn Guirriec et Anne Schneider et Thomas Pradeu et Nicolas Chevassus-au-Louis et le 276e Régiment d'infanterie et Marc Mouhanna et Jean-Yves Caradec et Pierre-Yves Le Priol et Violaine Barthélémy et Pierre Bessette et Yoshiko Tatsumi et Isidore, Isabelle Ramona et Milkias Gruenberg et Samuel de Cardaillac et Armelle Cloarec et le Quatuor des dissonances KV 465 et Jean-Pierre Klein et la duchesse de Brabant et David Louis Schindler et Virgile Novarina et Jean Seban et Jean Stoloff et Le Porche du mystère de la deuxième vertu et Charles Péguy
Transsubstantiation ?
sur L’Invention de l'année 2019
par Baltasar Gracián




















